Pauline Milani, Stéphanie Ginalski, Matthias Ruoss
Le 30 avril 1967, le photographe Jürg Hassler promène son objectif à la Landsgemeinde de Hundwil, à Appenzell Rhodes-Extérieures. Il en tire une série de clichés fascinants qui soulignent la forme exclusivement masculine de la démocratie, comme sur cette photographie. En 1967, seule une partie des Suissesses jouit des droits de vote et d’éligibilité sur le plan cantonal (Vaud, Neuchâtel, Genève et Bâle-Ville), un droit conquis de haute lutte ; les autres cantons résistent encore – Appenzell Rhodes-Extérieures jusqu’en 1989.
L’exclusion des femmes de la démocratie – car c’est bien d’exclusion dont il s’agit ici – est pourtant contestée, et depuis longtemps en Suisse. Mais les antisuffragistes ont pesé lourd à tous les échelons de l’État: les simples citoyens comme les hommes membres des législatifs, des exécutifs et du Tribunal fédéral, ont refusé de manière répétée et consciente de considérer leurs concitoyennes sur un plan d’égalité. Pour que le droit de vote et d’éligibilité des femmes dans l’ensemble des cantons soit accepté, il a fallu 53 votations cantonales – les citoyens du demi-canton d’Appenzell Rhodes Intérieures ayant quant à eux été contraints par une décision du Tribunal fédéral le 27 novembre 1990 de partager leur pouvoir politique avec les femmes.1

La photographie de Jürg Hassler – qui n’immortalise pas ici un vote relatif au suffrage féminin – témoigne ainsi d’un effet très concret de l’antiféminisme. La landsgemeinde, en réunissant physiquement les électeurs sur une même place, tenus de voter à bras levé les propositions, met en scène de manière directe l’homogénéité du corps électoral. Ici, comme le souligne le cadrage de Hassler, seuls les hommes participent aux décisions. D’autres clichés pris par le photographe à la même occasion2 montrent les femmes comme spectatrices des décisions prises par leurs conjoints, leurs frères, leurs voisins. Assistant silencieusement à cette démonstration de pouvoir masculin, les femmes font ainsi partie de la population, mais pas du peuple souverain.
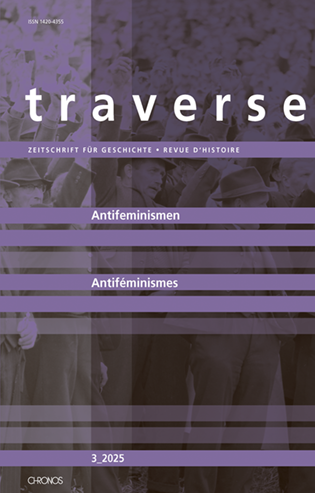
Le choix de cette image pour illustrer la couverture du numéro 3/25 de traverse rappelle que l’antiféminisme, comme contre-mouvement s’opposant à l’émancipation des femmes, représente une menace pour le vivre-ensemble et un danger pour la démocratie. L’antisuffragisme en constitue l’une des formes les plus visibles, mais n’est de loin pas la seule, comme le rappellent les contributions rassemblées dans ce numéro. Antiféminisme d’opinion, militant ou ordinaire, ciblant les droits politiques, économiques, reproductifs ou encore civils, toutes ces formes ont en commun leur substrat fondamentalement anti-égalitariste. Plusieurs articles rappellent par ailleurs que l’antiféminisme se conjugue fréquemment avec d’autres formes de haines, comme le racisme ou l’homophobie.
Alors que les attaques contre les droits des femmes et des minorités de genre sont de plus en plus visibles en Europe et dans le monde, la rédaction de traverse a choisi de contribuer modestement à résister au phénomène en consacrant ce numéro à son historicisation. En tant qu’historien·ne·s, nous pensons en effet que la connaissance du passé permet non seulement de mieux comprendre les enjeux actuels, mais qu’elle rappelle aussi l’importance de protéger nos droits et de s’opposer à la montée des haines. Résolument engagé, ce numéro annonce la couleur dès la couverture et s’inscrit dans une perspective féministe de lutte pour l’égalité.
- Seitz Werner, Auf die Wartebank geschoben. Der Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit 1900, Chronos, Zurich 2020. ↩︎
- La série est visible dans la collection Bild+Ton du Sozialarchiv, Bestand F_5068, url : https://www.bild-video-ton.ch/bestand/signatur/F_5068 ↩︎