
Le 30 avril 1967, le photographe Jürg Hassler promène son objectif à la Landsgemeinde de Hundwil, à Appenzell Rhodes-Extérieures. Il en tire une série de clichés fascinants qui soulignent la forme exclusivement masculine de la démocratie, comme sur cette photographie.
En 1967, seule une partie des Suissesses jouit des droits de vote et d’éligibilité sur le plan cantonal (Vaud, Neuchâtel, Genève et Bâle-Ville), un droit conquis de haute lutte; les autres cantons résistent encore – Appenzell Rhodes-Extérieures jusqu’en 1989.
L’exclusion des femmes de la démocratie – car c’est bien d’exclusion dont il s’agit ici – est pourtant contestée, et depuis longtemps en Suisse. Mais les antisuffragistes ont pesé lourd à tous les échelons de l’État: les simples citoyens comme les hommes membres des législatifs, des exécutifs et du Tribunal fédéral, ont refusé de manière répétée et consciente de considérer leurs concitoyennes sur un plan d’égalité. Pour que le droit de vote et d’éligibilité des femmes dans l’ensemble des cantons soit accepté, il a fallu 53 votations cantonales – les citoyens du demi-canton d’Appenzell Rhodes Intérieures ayant quant à eux été contraints par une décision du Tribunal fédéral le 27 novembre 1990 de partager leur pouvoir politique avec les femmes.1
La photographie de Jürg Hassler – qui n’immortalise pas ici un vote relatif au suffrage féminin – témoigne ainsi d’un effet très concret de l’antiféminisme.

Michèle Steiner et Christine Zürcher explorent dans cet article les liens entre le patriciat soleurois et les objets liturgiques.

L'image de couverture de ce numéro spécial a été réalisée par Denise Bertschi, dans le cadre de son projet doctoral (EPFL, Laboratoire des Arts et des Sciences) qui vise à explorer les liens complexes, imprégnés de colonialisme, entre Neuchâtel, en Suisse, et «Helvécia», à Bahia au Brésil, à travers le prisme de la culture visuelle et matérielle.
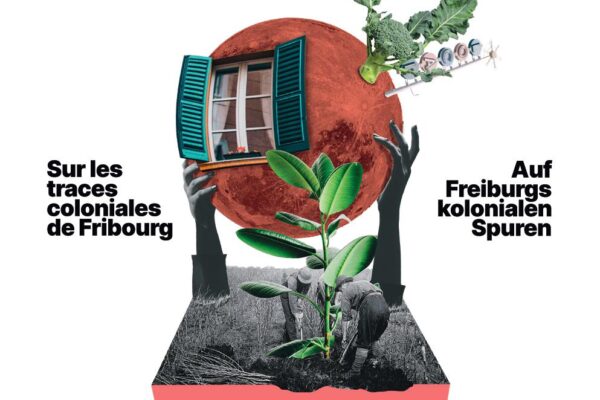
Ein Beitrag von Barbara Miller, Linda Ratschiller, Simone Rees
(Cet article n'est malheureusement disponible qu'en allemand.)
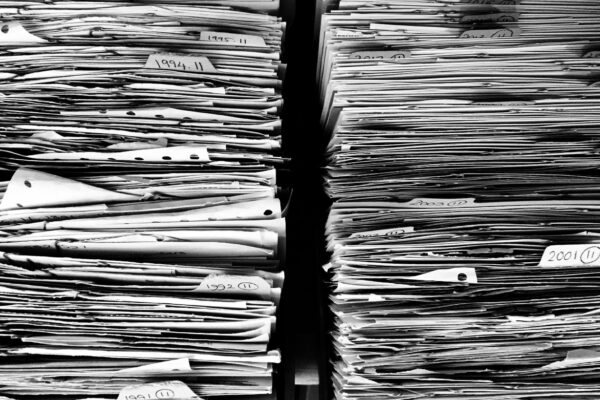
Alors que les progrès de la numérisation encouragent une diffusion plus large des données à caractère historique, les modalités d’accès aux fonds d’archives dits sensibles demeurent difficiles. En amont de toute recherche s’effectue un travail de négociation pour obtenir ou garantir l’accès à certaines sources d’archives, une démarche qui reste souvent peu explicitée lorsque les résultats des projets de recherche sont présentés.
Le cahier thématique 1/2023 de traverse s’intéresse ainsi aux questions que l’accès aux archives pose aux historien·nes, aux archivistes, et plus largement aux citoyen·nes qui souhaitent consulter des documents historiques.
ÉVÉNEMENT
L’accès aux archives est le thème d'une journée d'étude organisée par la section Politique scientifique de la Société suisse d’histoire (SSH) et traverse le 7 novembre 2023 à l'Université de Fribourg.

Au moment où paraît la troisième livraison de traverse sur les saisonniers·ères en Suisse en cette fin d’année 2022, la thématique paraît être au cœur de l’actualité. Alors que les stations de skis recherchent activement pour la saison qui s’ouvre une main d’œuvre devenue rare, deux expositions retracent le sort de ces travailleurs·euses migrants·es. Celui-ci fait l’objet depuis peu de réflexions historiques et mémorielles et est actuellement au cœur de deux expositions, à La Chaux-de-Fonds et à Bienne.

L'abbaye de Saint-Maurice en Valais, malgré ses 1500 ans d'histoire pleine de ramifications transcontinentales, mène – dans une perspective transversale et postcoloniale – une existence à peine remarquée dans l'histoire suisse (article dans le DHS). Il pourrait pourtant être extrêmement instructif pour la recherche de se pencher sur l'abbaye et sur l'histoire de saint Maurice.
Selon la légende, Maurice est originaire de Thèbes, dans l'actuelle Égypte. En tant que chef de la légion thébaine, il aurait souffert le martyre à Agaune à la fin du 3e siècle. Au cours des 200 années suivantes, un lieu de pèlerinage chrétien central et précoce s'est développé autour de la tombe et des reliques de saint Maurice et, en 515, le fils du roi de Bourgogne, Sigismond, a initié la construction du monastère: le saint de Thèbes s'est avéré être un garant de succès local. Après une histoire transculturelle de 600 ans, qui a réuni à Saint-Maurice des personnes, des objets et des idées de Byzance à la Bourgogne, le transfert des reliques du Maurice «africain» dans la cathédrale de Magdebourg, initié par Otton I en 961, a sonné le glas de la provincialisation de Saint-Maurice. Alors que la châsse de Sigismond dans le trésor de la cathédrale de Saint-Maurice datant du 12e siècle adaptait le saint en tant que chevalier "ouest-européen", la sculpture du saint placée bien en vue à Magdebourg témoigne de son stéréotype culturel et visuel au 13e siècle en tant que saint «d'Afrique».
(I. Schürch)
(Traduction: I. Schürch et T. Giddey)

Frédéric Sardet in traverse 21/1 (2014)
«J'aime la notion de «moment», qui introduit aussi bien à la mécanique qu'à des considérations sur le temps. La création de la revue traverse, en 1994, a été pour moi un «moment» dans le sens où elle devait être une force capable de faire pivoter (en aucun cas de révolutionner) le dispositif de communication des recherches historiques en Suisse et à titre plus personnel – parce que la participation au comité de rédaction constitua une dimension importante de ma vie professionnelle jusqu'en 2005. De manière plus fondamentale, je rappellerai ici les conditions qui ont présidé à la mise en place du premier comité de rédaction, telles que je les ai gardées en mémoire et telles que mes archives personnelles me permettent de les restituer.»